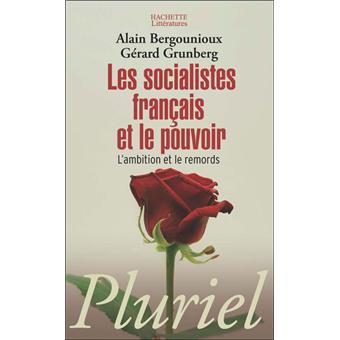
Les socialistes français et le pouvoir - Alain Bergounioux - Gérard Grunberg
Une histoire des socialistes, depuis la création de la SFIO en 1905 jusqu’à aujourd’hui (2007) et de son rapport à la conquète et à la pratique du pouvoir.
L’ouvrage est volumineux et très documenté, il vise à étudier le rapport au pouvoir des socialistes (SFIO et parti socialiste actuel) depuis sa création.
Le volume démontre de façon assez convainquante les impasses du PS sur ce sujet, en s’appuyant sur un modèle théorique - la génétique du parti - confronté à l’histoire du parti sur le siècle passé (1905-2007) :
Le politologue Italien Angelo Panebianco a utilisé le modèle génétique pour l’étude des partis politiques, montrant que le moment fondateur est essentiel pour comprendre sur une longue période la manière dont un parti politique gère ses relations, à la fois internes et externes.
Ceci, se traduit, pour le parti socialiste, par un positionnement assez singulier par rapport à ses homologues européens :
Tout au long de ses cent années d’existence, le parti socialiste français a vécu le processus de son intégration au système politique de manière à la fois heurtée et contradictoire dans son action et insatisfaisante voire douloureuse dans la conscience de ses militants. Il a, plus longtemps que ses homologues européens, tenté d’échapper aux responsabilités du pouvoir, puis lorsqu’il l’a exercé, il a vécu cet exercice comme une série de reniements voire de trahisons, et il a tenté, après chaque nouvelle expérience, de renouer avec ce qui, à ses propres yeux, constituait le fond de son identité, c’est à dire une volonté de rupture et non de compromis, s’opposant à toute révision réelle de sa doctrine quand les autres partis socialistes acceptaient des ajustements plus larges, mieux théorisés et plus facilement assumés entre leurs principes originels et ceux de la démocratie libérale.
Sans chercher à retracer ici la totalité de l’historique du parti, et de ses différentes périodes d’exercice du pouvoir (largement développés dans l’ouvrage), je vais simplement mettre en avant quelques éléments me semblant saillants.
Un des premiers éléments constitutif de la culture du parti est son rapport à la république. En effet, contrairement à d’autres pays, le mouvement d’industrialisation a coïncidé avec l’établissement de la démocratie représentative et de la création des mouvements ouvriers associés (selon des modalités et des temporalités qui ont pu varier d’un pays à l’autre). Dans ces contextes, les combats sociaux et les combats pour les libertés démocratiques (en particulier le suffrage universel) ont pu se trouver liées. En France, au contraire, suffrage universel (1848) à précédé le mouvement d’industrialisation, ainsi, les effets de la révolution industrielle ont dominé la conscience collective tandis que le suffrage universel était établi. Si le parti a largement évolué sur ce sujet, et affiche maintenant une volonté de sincrire dans l’exercice des institutions, il en substite une certain méfiance vis-à-vis de celles-ci, méfiance qui peut émerger dans certaines situations.
Le parti socialiste unifié de 1905 n’a pu ainsi revendiquer pour lui seul l’obtention de la démocratie politique. C’est pourquoi son attachement à la démocratie parlementaire a été plus empreint de critique que celui d’autre grand partis socialistes européens qui ont porté la lutte pour l’extension du droit de suffrage et pour qui, tout naturellement, une fois la victoire obtenue, l’attachement aux procédures du parlementarisme démocratique est devenu partie intégrante de leur culture politique. En France, la question sociale a longtemps dominé la conscience collective après que le suffrage universel et le parlementarisme eurent été établis. Cela a fortement contribué à asseoir dans le mouvement ouvrier, et tout particulièrement dans le syndicalisme, la croyance que l’un et l’autre ne résolvaient pas la “question sociale”.
Ceci s’est manifesté, par exemple, par un refus longtemps répété de participer à un gouvernement “bourgeois” par nature. Par ailleurs, le parti a largement adhéré à une conception marxiste de la société, fascination renforcée par l’emprise qu’exerce la révolution sur l’imaginaire de la gauche française.
Le caractère scientifique attribué au marxisme a donné aux militants la conviction de détenir la vérité historique. Ses perspectives politiques, qui ont conflué avec les souvenirs révolutionnaires, ont accentué la vision conflictuelle de la société, par l’opposition de deux classes essentielles, portée à l’échelle internationale, donnant ainsi une interprétation complète du monde moderne.
Toutefois, si la création de la SFIO a permis de rassembler un ensemble de mouvements au sein d’une même structure, l’unité de ce parti n’a pas été allant de soi, tiraillée entre différents courants, parfois violemment opposés. La façon dont a géré le parti ces mouvements centrifuges a été de centrer son fonctionnement autour d’une doctrine à la fois minimale et centrale.
L’accord minimal sur la doctrine a permis de faire vivre ensemble des tendances qui n’avaient pas la même conception de l’action politique. Le parti n’exigeait de ses adhérents que le respect des règles communes et l’accord de chacun sur les fins dernières, c’est-à-dire la réalisation du socialisme. Les conflits portant sur la pratique politique ne pouvaient être tranchés qu’en référence à la doctrine dont l’interprétation était l’enjeu essentiel lors des discussions de congrès. Dans la mesure où la légitmité de l’action parlementaire n’était pas reconnue pour elle même, chaque tendance pouvait exiger que toute transaction avec le système politique appelât une justification de son bien fondé devant le parti, devant les militants. C’est pourquoi la doctrine, quel que fut son caractère rudimentaire à plusieurs égards, tenait une place considérable dans le fonctionnement même du parti. Ceux qui, en son sein, se trouvaient en situation d’être les interprètes les plus légitimes étaient en position de force.
Il résulte de cette construction un mouvement politique dissonant, se caractérisant par une volonté de ne jamais renier un projet initial de nature révolutionnaire, et dans le même temps inscrire son action dans les institutions républicaines à mesure que celui-ci gagnait du terrain électoral. Dans le même temps, le parti apparaît comme une structure essentiellement tournée sur elle même, focalisée sur le respect de sa doctrine (Il est frappant de voir à travers différents exemples comment différents candidats aux élections présidentielles récentes - De François Mitterrand à François Hollande, ont oeuvré pour s’échapper de cette contrainte doctrinale). Cette contrainte, en réalité insoluble, a souvent été “résolue” par des pirouettes dialectiques ou sémantiques, plus ou moins brillantes, mais ne tranchant jamais l’ambiguité fondamentale (et le parti a connu des plumes singulièrement talentueuses dans cet exercice, à travers des personnes telles que Jean Jaurès, Léon Blum, ou encore François Mitterrand).
Il ne peut résulter de cette dissonance que de la déception, voire une forme d’amertume, lorsque le parti se confronte à la réalité du pouvoir : puisqu’il n’a pas mis en oeuvre son projet annoncé comme étant révolutionnaire (même s’il est souvent annoncé comme ne devant arriver qu’à des horizons très incertains), il ne peut-être soupçonné que de reniement, voire de trahison.
Un des intérêts de l’ouvrage tient dans la révélation des dynamiques qui se mettent en place, au sein du parti : nous voyons se mettre en oeuvre un double jeu, interne et externe, inlassablement répétée à travers différents épisodes au gré du siècle passé,
En interne (Le propos cité est de Frédéric Bon et Michel-Antoine Burnier, dans une postface d’un ouvrage d’Eduard Bernstein dans Les présupposés du socialisme), les dynamiques du pouvoir se déroulent de la façon suivante :
Trois personnages apparaissent à chaque fois, droite, gauche et centre, qui s’apostrophent, s’allient, s’excommunient ou s’exterminent tour à tout. L’analyse conventionnelle veut qu’on situe les protagonistes sur une ligne imaginaire - le centre entre les deux extrêmes, moins laxiste que la droite, plus réaliste que la gauche […]. Chacun se dispute et s’efforce de repousser le point de clivage, le plus à gauche possible pour les révisionnistes, le plus à droite pour les révolutionnaires […]. Les rapports entre les acteurs s’organisent selon trois axes qui opposent alternativement deux des protagonistes au troisième. Les premiers axes sont directement perceptibles et apparaissent comme tels dans le heurt des idées. C’est d’abord celui de la théorie politique : il oppose l’orthodoxie à l’hérésie, la théorie marxiste révolutionnaire à la révision. Sur cette ligne de clivage, la droite est isolée et affronte la coalition du centre et de la gauche unie par la conservation des principes sacrés de la doctrine. La situation s’inverse sur le second axe, la pratique politique. La gauche est isolée, qui préconise une radicalisation de la ligne politique ; centre et droite s’accordent sur une politique de temporisation : opportunisme et refus de l’aventure révolutionnaire. Ces deux partages, les seuls qui soient effectivement évoqués dans le débat, situent effectivement le centre dans une position médiane et rejettent droite et gauche aux extrêmes. Le dernier axe de l’affrontement est en revanche rarement perçu par les acteurs : il concerne la nature même du débat. Droite et gauche combattent chacune à leur façon pour abolir la distance qui sépare la théorie de la pratique : ajuster la théorie à la pratique réformiste pour la première, la pratique à la théorie révolutionnaire pour la seconde […]. Le centre n’appartient pas à cet univers. Cette distance entre la théorie et la pratique fonde son existence même ; il l’élargit à la mesure des nécessité de son pouvoir et de son autonomie.
En externe, se joue un autre jeu, celui de la recherche d’alliances. En effet, si le parti a longtemps été dominant à gauche (en concurrence avec le PC, selon les périodes), il ne l’est cependant pas suffisamment pour espérer accéder seul au pouvoir : l’envie de gouverner suppose de superposer à la contrainte d’unité en interne, une contrainte d’unification des gauches en externe. Ici, pris au piège de sa doctrine - qui l’empêche de se rapprocher d’un centre intrinsèquement vu comme trop “bourgeois” et inévitablement “de droite”, celui-ci se tourne invariablement vers sa gauche (Le PC, puis les Verts, puis aujourd’hui LFI).
Il se prive ainsi d’un espace politique, par soucis de préserver la conformité à sa doctrine, et prend le risque de brouiller encore plus son message et son positionnement. Il ne sera jamais aussi révolutionnaire que les vrais partis révolutionnaire, et son refus de regarder au centre peut finir par faire fuir ses électeurs les moins convaincus par le folklore révolutionnaire, au risque de ne plus disposer d’espace du tout comme le montre la séquence actuelle.
“Le congrès d’Epinay”
liens :
- les socialistes et le déni du centre
- Alain Bergounioux, Gérard Grunberg, Le long remords du pouvoir. Le Parti socialiste français, 1905-1992 - compte-rendu
Points à approfondir (peut-être plus tard, probablement jamais, mais ce sont des sujets auquel je pense en écrivant la chronique) :
- comprendre comment le syndicalisme s’est construit en autonomie (et souvent, en méfiance), vis-à-vis de la sphère politique, et en quoi il diffère ainsi d’autres mouvements syndicaux européens, où la collaboration avec les partis politiques semble plus forte (générant ainsi une autre faiblesse de la gauche française, que je n’ai pas mise en avant dans cette note). Une note de l’institut Montaigne aborde (partiellement) le sujet.
[Corps intermédiaires : accords perdus de la démocratie ?]