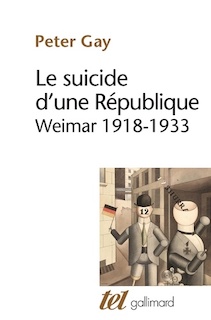
Plus qu’un ouvrage historique ou politique, L’ouvrage propose un portrait intellectuel et culturel de l’Allemagne sous la république de Weimar, à travers l’étude de différents champs culturels et universitaires : l’histoire, la peinture, la littérature, le théâtre, le cinéma, l’architecture, etc.
Née dans la débâcle de la défaite de 1918, sous les auspices d’un traité de Versailles vu comme honteux et déshonorant, la république de Weimar connaît des débuts violents - ponctués d’assassinats politiques - et la fin tragique que l’on connaît, timidement soutenus par des républicains souvent modérés et eux-même peu enthousiastes, résolument combattue par les extrêmes gauche et droite, le régime a également souffert d’une “atmosphère culturelle” peu propice à sa préservation, atmosphère qui prend ses racines bien au delà du choc de la première guerre mondiale ainsi que d’une forme de “trahison des clercs” (ou en tout cas de certains d’entre eux, parmi lesquels nous pourrons citer les universitaires - j’y reviendrais plus tard - et le monde de l’administration)
La même atmosphère irréelle caractérisa le maintien à leur poste des fonctionnaires impériaux. Au vu de la structure autoritaire traditionnelle de la société allemande, que la révolution n’avait guère cherché à secouer, les conséquences de cette politique étaient prévisibles. La démocratie allemande demeurait assez fragile pour n’avoir pas besoin en outre de l’intertie ou de l’hostilité des fonctionnaires. L’administration allemande était célèbre dans le monde entier pour son efficacité et sa neutralité, mais sous la République elle utilisa essentiellement ses remarquables compétences à des actes de sabotage ; apparemment, sa loyauté proverbiale à l’égard de l’autorité hiérarchique ne s’étendit pas aux ministres socio-démocrates ou libéraux. Mais l’exemple le plus frappant de ce recours sophistique à des principes d’indépendance et d’objectivité – terrain propice et favorable au développement du cynisme chez ceux qui, à droite, en bénéficiaient comme chez ceux qui, à gauche en pâtissaient – tient à la conduite des juges, procureurs et jurés de la République. Les juges qui avaient survécu à l’empire reprisent du service après la révolution ; ils étaient inamovibles et, ainsi que leur comportement devait le démontrer, inébranlables : ils étaient presque tous issus des ordres privilégiés, et si leur liens étroits avec les aristocrates, officiers et politiciens conservateurs, ne les inclinaient guère à la pitié envers les communistes inculpés, ils se montraient d’une indulgence courtoise à l’égard des anciens officiers.
Ceci se traduit, par exemple, envers une certaine indulgence, pour ne pas dire cécité, envers les nombreux auteurs d’assassinats politiques d’extrême droite, voire les auteurs de tentative de putsch.
On retrouve la même continuité entre l’empire et la république dans le monde universitaire, ce qui se traduit par une continuité des habitudes d’études antérieures, aussi bien sur un plan méthodologique (le refus de champs d’étude nouveaux venant enrichir la pratique de la recherche, par exemple, les apports que la sociologie et les travaux de Max Weber pourraient apporter à l’étude de l’histoire.), des sujets étudiés (une très grande partie des sujets d’études vise à rechercher dans l’histoire de l’Allemagne des personnages et des événements illustrant une certaine idée a priori de l’Allemagne.
C’étaient là, dans le choeur des historiens allemands, les voix des grands anciens. Il n’est pas surprenant qu’en 1931 Hajo Holborn eût noté peu de progrès vers l’objectivité scientifique chez ses collègues. “Les transformations profondes constatées dans tous les domaines de la vie sociale, politique et intellectuelle et qui sont la conséquence de la guerre mondiale”, écrivait-il dans la Historische Zeitschrift, avaient “à peine touché le noyau des études historiques scientifiques”. Les vieilles “traditions et institutions” universitaires avaient été suffisamment fortes pour rendre extrêmement rare toute “critique des procédures habituelles, des directions et des objectifs de la recherche et de l’écriture historique” ; ce qui était encore plus manifeste, c’était “une certaine fierté” provoquée par la découverte que “très peu des idéaux dont on avait hérité devaient être abandonnés”. Trop d’historiens se prenaient pour des héros parce qu’il “nageaient à contre courant de leur époque”. Mais, avertissait Holborn, cette “inclinaison vers une espèce de foi des Nibelung” n’était rien moins que de “l’autosatisfaction”, le simple symptôme d’une absence de réflexion et d’un aveuglement qui menaçaient de “devenir dangereux pour notre métier”.
L’ensemble donne une impression d’ambiance assez irréelle, avec des débats qui prennent la forme de confrontation de mythologies, souvent divergentes voire antagonistes : elles s’opposent frontalement, plus qu’elles ne dialoguent ; désir réactionnaire de retour à l’ordre ancien d’un côté, pulsions révolutionnaires de l’autre, chacun des deux bords restant imperméable (au sens où il n’y a d’autre contact que confrontationnel - possiblement violent) à l’autre ; et les extrêmes se réunissant dans leur détestation de la république et de la démocratie parlementaire, dans un univers médiatique et intellectuel très clivé.
Kantorowisz n’était pas un vulgaire propagandiste ; en fait, il n’était en rien un propagandiste. Mais il mit dans sa biographie toute son expérience et toutes ses espérances. Juif par ses origines, officier prussien par vocation, Kantorowicz avait rejoint les Freikorps après la guerre et pris les armes contre la gauche ; pour lui, la République consacrait le triomphe de la médiocrité, un âge sans dirigeant. C’était un érudit accompli mais, en tant que membre du cercle de Stéfan George, il ne professait que mépris pour le froid positivisme de l’érudition scientifique moderne, et sa compréhension historique des grands hommes et des grandes périodes de l’histoire passait, non par l’analyse, mais de fulgurantes intuitions. L’empereur Frédéric – un surhomme qui avait défié toute forme d’autorité et goûté à la vie avec voracité pour devenir une légende de son vivant – constituait un sujet d’intérêt évident pour un tel historien.
(…) En un temps où il n’y avait plus d’empereur, affirmait-il dans son introduction incisive, “une Allemagne secrête” aspirait à retrouver “ses empereur et ses héros”. Et son livre offrait à cette Allemagne secrète force nourriture agréables : le Frédéric II de Kantorowisz apparaissait comme le père de la Renaissance et comme un chef d’état digne de rivaliser avec Alexandre le Grand. (…) Frédéric II était mort, et cependant il demeurait toujours vivant, attendant de racheter un peuple allemand incapable encore de comprendre sa véritable grandeur et son essence semi-divine. Kantorowisz ne se contentait pas de rapporter de simple légendes médiévales : son langage, par son caractère hyperbolique, son imprécision scintillante, sa façon béate de toute approuver, était l’expression d’une communion des plus tendancieuses – je suis tenté de dire érotique – avec son sujet d’étude et impliquait une foi en ces légendes vues comme autant de vérités profondes, susceptibles de s’appliquer à une Allemagne souffrante. Le fait que la biographie de Kantorowisz s’appuyât sur des connaissances historiques fiables rendait son mythe encore plus convaincant pour les érudits, et encore plus dangereux pour la république. C’était de l’histoire, mais sous forme de poésie politique.
La république de Weimar a également été une période de très grande vitalité artistique : littérature (Thomas Mann, Stefan Zweig), art graphiques (expressionnisme), architecture (le mouvement du Bauhaus), théâtre (Bertolt Brecht) et cinéma, qui ont déployés dans leurs arts respectifs à la fois une très grande fécondité et une forte inquiétude, où règne l’ombre de la mort et du désastre. L’oeuvre la plus emblématique de la période étant La Montagne Magique
Mais plus profondément – par delà le roman réaliste et le roman d’éducation – on découvre le roman symbolique à la “dialectique musicale”. Le sanatorium est un simulacre d’une civilisation européenne trop mûre, fatiguée de la paix, prête pour la danse de la mort, ostensiblement prospère mais secrètement corrompue ; sa clientèle internationale, ses commérages, ses jeux amoureux, son psychanalyste d’un genre douteux et ses accès encore plus suspects d’occultisme, ses patients surtout, aux joues empourprées, friands de promenades, qui cachent ou exposent tour à tour le mal qui les ronge (les tuberculeux, toujours en proie à une légère fièvre, paraissent souvent en meilleure santé que les gens sains) tout cela est observé avec lucidité mais évoque également une manière de Heartbreak house. Et Mann peuple ce sanatorium, modèle réduit de l’Europe à la veille de la Grande Guerre, d’archétypes tous également volubiles ; ils ont pour rôle de former Hans Castorp au cours d’un majestueux corps à corps où se mêlent tous les courants de pensée qui, depuis des siècles, divisent le vieux continent.

George Grosz (1893-1959), Route dangereuse, 1918.